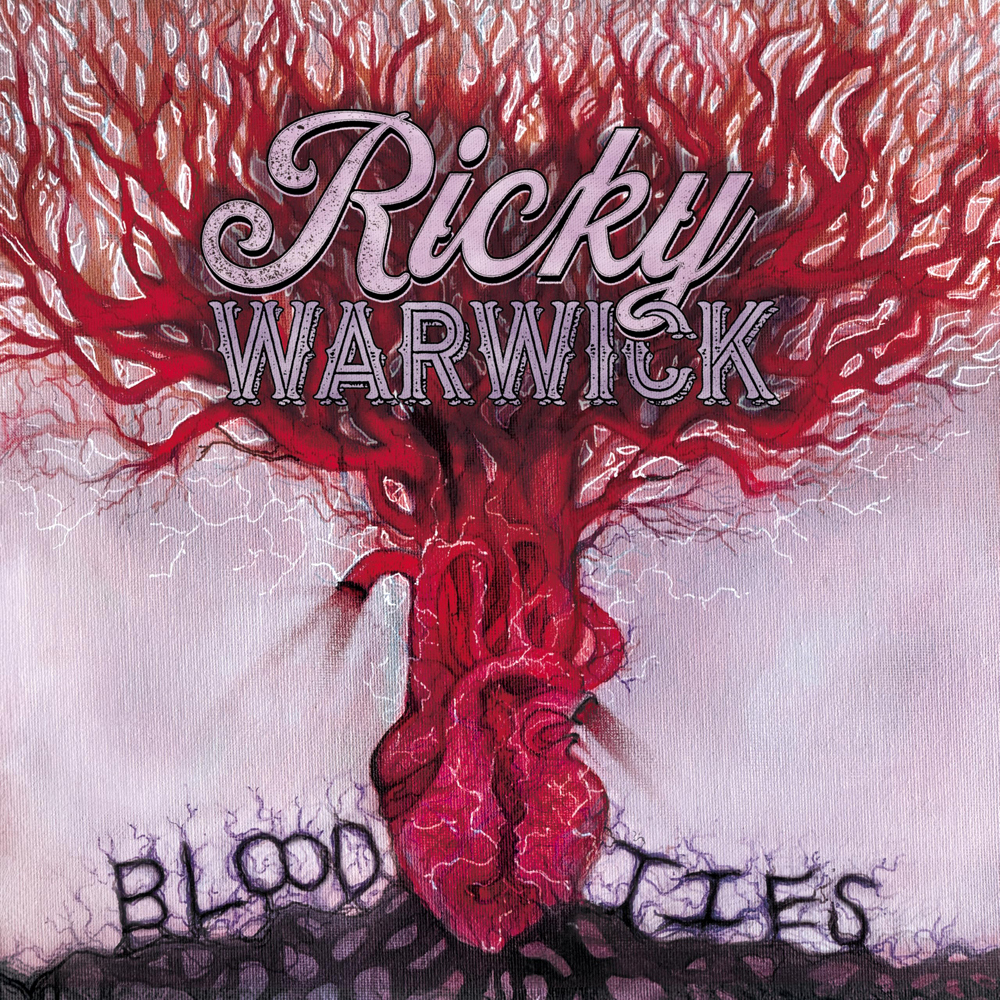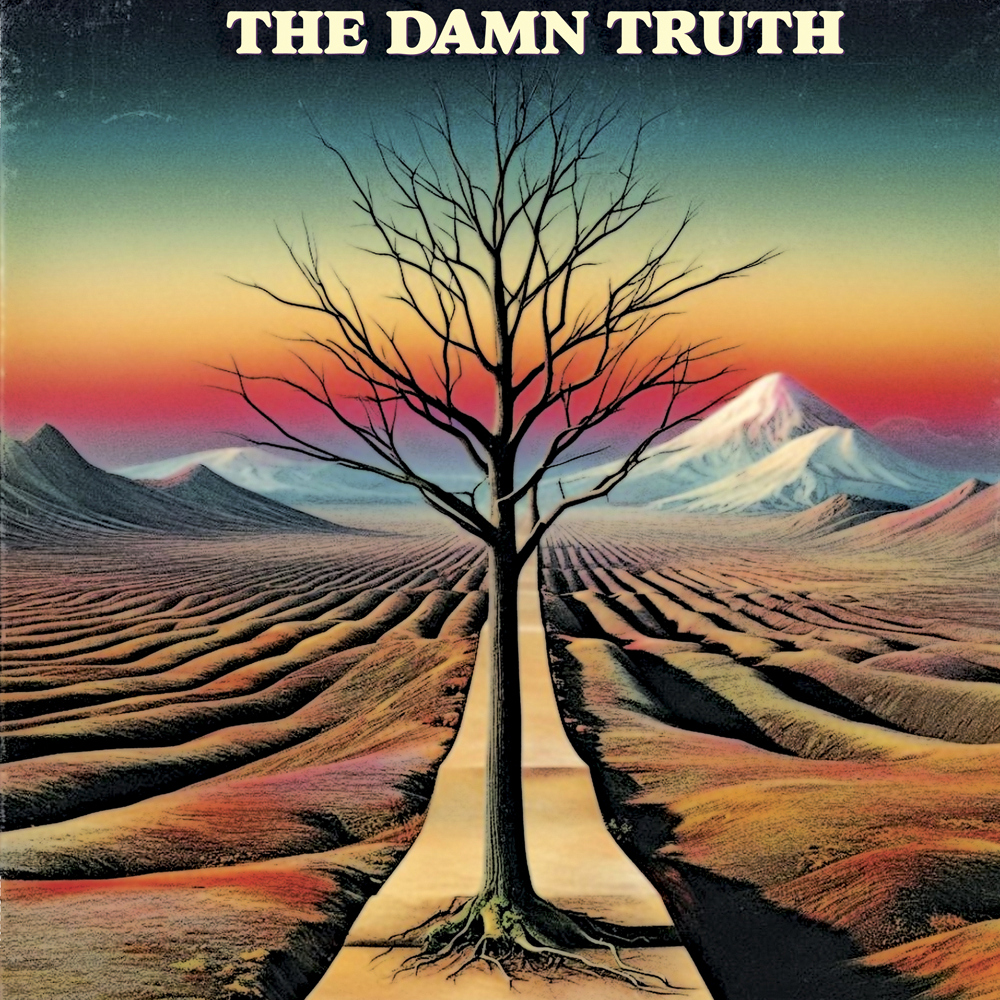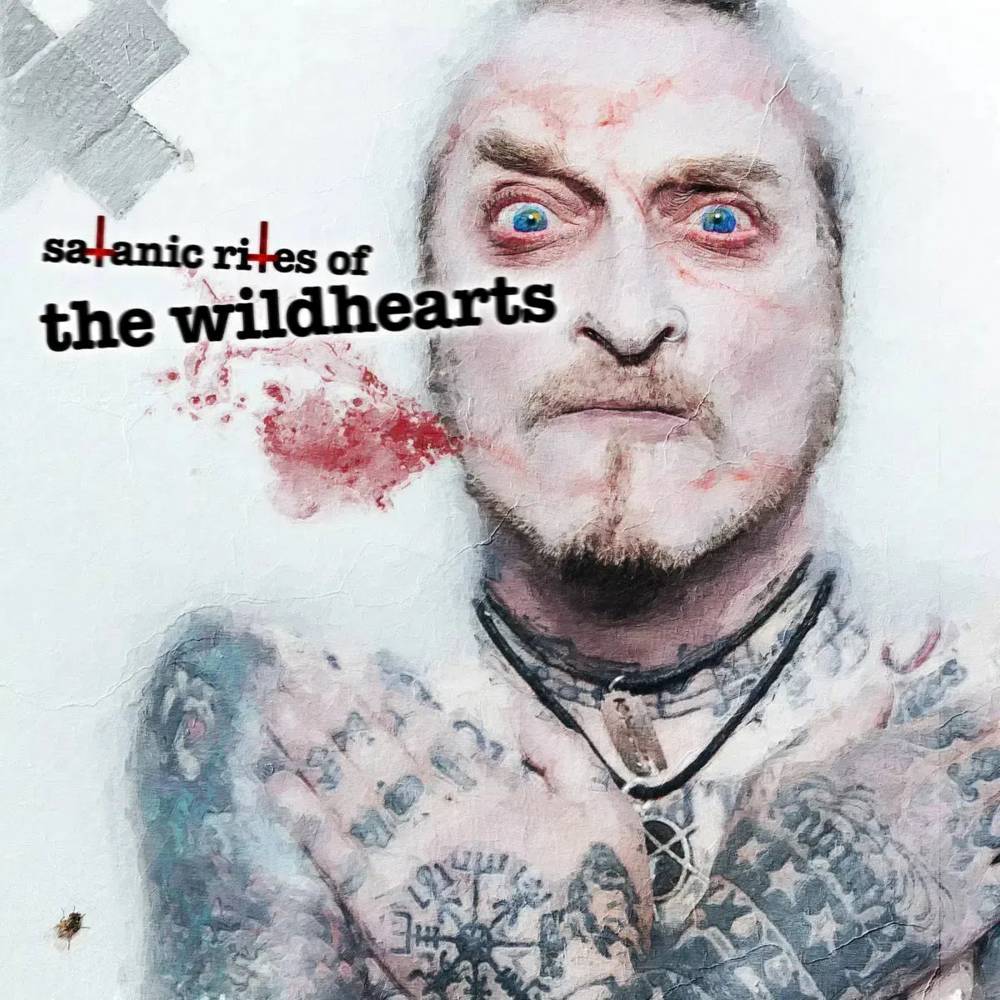Indémodable et toujours aussi fringuant, L.A. GUNS reste ce combo attachant, parfois surprenant, et bondissant souvent là où on ne l’attend pas. En quatre décennies d’une carrière sinueuse et improbable à l’occasion, il reste cette formidable machine à riffs, aux mélodies intemporelles et avec cette manière toute personnelle de faire des disques avec une déconcertante facilité. Une fois encore, l’expérience et l’inspiration brillent sur ce « Leopard Skin », dont on n’est pas près de se lasser.

L.A. GUNS
« Leopard Skin »
(Cleopatra Records)
Huit ans après l’heureux rabibochage entre le guitariste Tracii Guns et son frontman Phil Lewis, L.A. GUNS fait toujours vibrer son Sleaze Rock, qui respire le Sunset Strip à plein poumon, là où d’autres ont depuis longtemps déposé les armes. Et comme pour mieux célébrer cette incroyable longévité, notre infatigable quintet souffle cette année ses 40 bougies. D’ailleurs, à l’écoute de « Leopard Skin », on peine à croire que les Américains soient encore capables de livrer des albums d’une telle fraîcheur… le quinzième en l’occurrence et sûrement pas le dernier.
Bardé de riffs affûtés comme s’il en pleuvait, L.A. GUNS n’a rien perdu de son mordant et se fend même d’un opus parfaitement ancré dans son temps, à mille lieux de toute nostalgie, et qui aurait même pu faire rougir certaines formations du temps de la splendeur de la Cité des Anges. Increvables et créatifs, nos vétérans paraissent sortir tout droit d’une cure de jouvence et vont carrément jusqu’à redonner foi en un style qui s’effrite au point de devenir aujourd’hui presqu’invisible. « Leopard Sin » transpire le Rock’n’Roll par tous les pores et devient vite addictif.
Racé sur « Taste It », plus classique sur « Hit And Run », presque champêtre sur « Runaway Train », fusionnel sur « Lucky Motherfucker », bluesy sur « The Grinder » ou grinçant sur « I’m Not Your Candyman », L.A. GUNS sort l’artillerie lourde et se montre largement à la hauteur de sa légende. Entre refrains entêtants et solos incandescents, les Californiens bénéficient de surcroît d’une production puissante et limpide, qui laisse exploser leur panache et une énergie toujours aussi présente. Direct et efficace, le groupe a un sens inné de ce Hard Rock débridé qui devient si rare.

Retrouvez les chroniques des deux albums précédents :