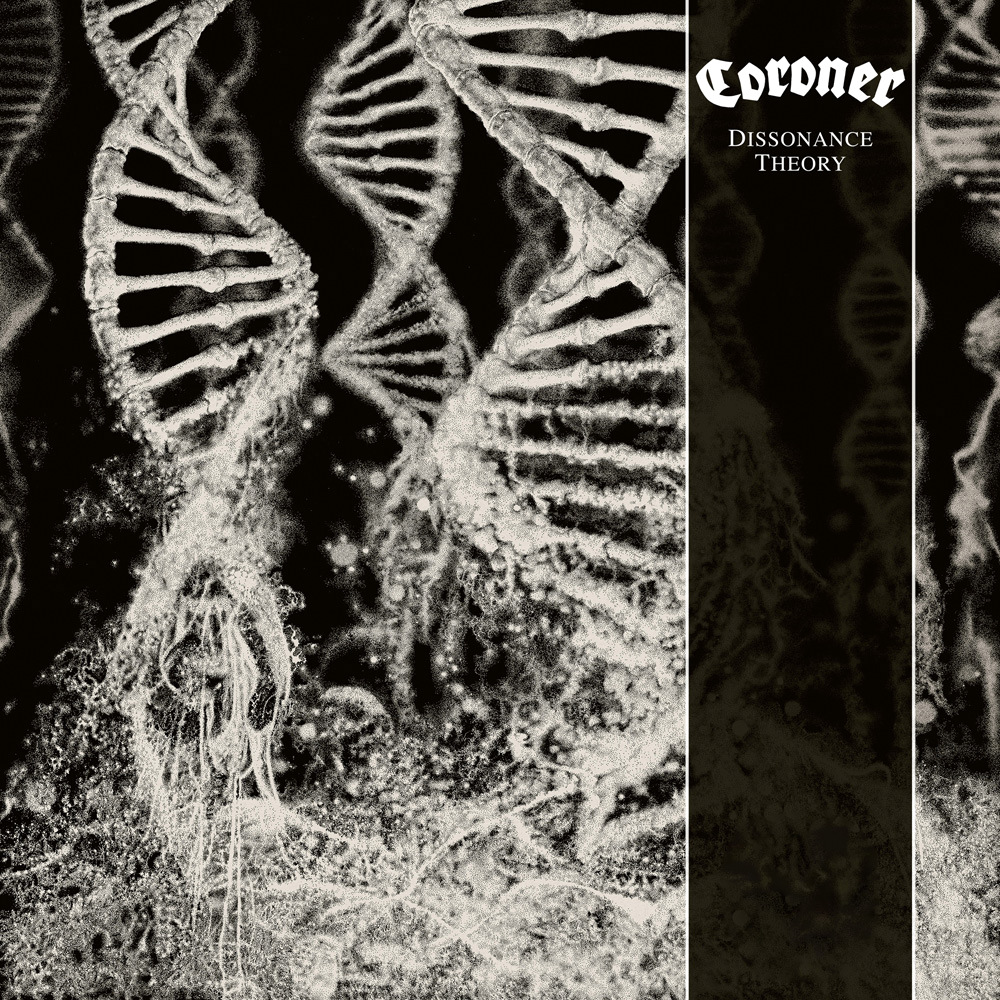Au croisement d’un Heavy Stoner, d’un Doom Rock et d’un post-Metal captivant, TEMPTRESS est littéralement inclassable. Une sorte de Stoner hybride à l’œuvre depuis 2019 déjà et que le power trio de Dallas alimente depuis deux albums, en prenant bien soin de ne s’attacher à aucune chapelle. Le groupe a la particularité d’évoluer entre chant féminin et masculin élargissant un peu plus encore son champ d’action. Andi Cuba (batterie, chant), Kelsey Wilson (guitare, chant) et Christian Wright (basse, chant) imposent finalement leur personnalité pour se retrouver dans une unité artistique d’une cohérence incroyable et d’une créativité sans limite. A l’occasion de la sortie de « Hear », les Américains reviennent sur ce concentré de puissance si libre et maîtrisé.

– Trois ans après « See », vous faites votre retour avec « Hear », un album encore plein de surprises. La première est que l’atmosphère est moins Doom et étouffante et la production moins sombre. Vous aviez l’envie d’apporter et de laisser plus de lumière dans l’univers de TEMPTRESS ?
Oui ! C’est très différent de « See ». Avec ce nouvel album, nous avons cherché à obtenir un son plus authentique, quel que soit ‘notre son’. Je crois qu’il retranscrit parfaitement notre expérience en concert : puissante et intense, une véritable immersion visuelle et auditive.
– L’autre particularité de « Hear » est le songwriting. Vous êtes trois musiciens très aguerris à la scène et il régnait un réel esprit Jam sur votre précédentes réalisations. Or, ce nouvel album est très précis dans son écriture. Vous avez ressenti le besoin de plus structurer vos morceaux cette fois-ci ?
Eh bien, en tant qu’amis et musiciens, nous avons évolué. Pendant nos premières années, nos répétitions étaient souvent des jams improvisées, dans une ambiance spontanée, le temps d’apprendre à nous connaître musicalement. On jouait tous à l’oreille et ça a beaucoup contribué à notre style. Quand on a commencé à travailler sur un deuxième album, on voulait faire des morceaux plus courts et plus intenses, des titres faciles à chanter. Pendant le processus d’écriture, chacun avait des chansons sur lesquelles il travaillait de son côté, avec une idée précise de ce qu’il voulait en faire. On s’est réunis pour donner vie à ces idées, moins pour la composition et la structure, mais plus pour concrétiser la vision de chacun.

– L’une des forces de TEMPTRESS est aussi d’être trois au chant. Comment est-ce que vous vous partagez les rôles ? Chacun chante-t-il ses propres compositions, ou choisissez-vous la personne la plus adaptée suivant les tonalités du morceau ?
C’est un peu des deux. Nous chantons parfois nos propres morceaux, mais d’autres fois, nous chantons ensemble ou nous laissons quelqu’un d’autre prendre le relais. Nous jouons en accordage standard de ré ou en drop do, ce qui semble bien convenir à notre tessiture. Christian ayant un registre plus aigu, nous pouvons facilement nous répartir les parties vocales et imaginer les différentes possibilités qu’offrent un couplet ou un refrain.
– Chacun d’entre-vous a un timbre de voix et un style de chant différent. Quelle est votre principale difficulté, s’il y en a une, pour conserver l’identité musicale de TEMPTRESS ? Est-ce la musique qui prime, ou plutôt le contenu des textes ? Ou les deux…
Les deux, bien sûr ! Parfois, en écrivant, la musique ou le riff vient en premier et inspire les paroles, et inversement, les paroles que l’un de nous apporte inspirent la musique. Notre priorité est de composer une musique qui nous ressemble, quel que soit le genre. Je crois que notre identité musicale, c’est nous trois ensemble.

– Vous ouvrez « Hear » avec une intro assez longue et entièrement instrumentale. C’est morceau lumineux et très post-Rock. C’est un choix qui peut surprendre compte tenu de la suite de l’album. L’idée était-elle justement d’imposer une atmosphère précise dès le début ?
Absolument, dans le même esprit que « Death Comes Around » de « See », nous créons une atmosphère qui vous transporte dans notre univers. L’album possède une versatilité et un dynamisme presque bipolaires : chaque morceau est différent, chaque monde que vous explorez est unique. L’intro vous met en appétit et vous invite au voyage.
– Par la suite, l’album est très varié et vous évoluez dans une multitude de registres allant du Stoner au post-Metal avec des éléments Doom bien sûr et même très Rock 90’s. Est-ce que, finalement, TEMPTRESS n’ouvre-t-il pas les portes d’un post-Stoner, selon vous ?
La musique est tellement subjective que chaque auditeur peut y entendre ce qu’il veut. Oui, je suis d’accord, tous ces éléments sont présents et c’est parce qu’on les apprécie ! Si l’auditeur y entend du post-stoner, nous lui laissons cette possibilité.

– « Hear » est également à ranger parmi les albums oniriques, sans être exclusivement atmosphérique pour autant. Et il est aussi très conceptuel dans la forme. Est-ce que vous définissez une ligne artistique globale avant même de commencer la composition ?
Non, pas tellement sur cet album. L’atmosphère onirique s’est imposée naturellement, de façon organique, grâce à notre style d’improvisation. Nous n’y avions pas pensé avant de composer l’album.
– Enfin, vous avez aussi changé de label, puisque « Hear » sort chez Blues Funeral Recordings, tandis que « See » était sorti chez Metal Assault Records. Et Ripple Music s’apprête à ressortir votre premier album en mars. A quoi sont dus tous ces changements, et comment expliquez-vous cette surprenante dispersion ? A moins que ce ne soit qu’un concours de circonstance ?
C’est vraiment une coïncidence. Notre contrat avec Metal Assault Records arrivait à échéance à peu près au moment où nous avons rencontré Jadd de Blues Funeral Recordings. Nous avions entre les mains notre album « Hear », fraîchement enregistré, et nous cherchions désespérément un label pour le distribuer. Blues Funeral Recordings est un label formidable et ils nous ont vraiment aidés à évoluer et à nous développer sur la scène musicale. Alors qu’ils étaient très occupé par la sortie de « Hear », nous étions impatients de trouver un distributeur européen pour la réédition de « See », un album essentiel pour notre avenir. Une fois toutes les parties prenantes d’accord, nous nous sommes adressés à Ripple Music et leur avons demandé une réédition. Heureusement, ils ont accepté et nos fans européens pourront se procurer un exemplaire très prochainement ! (L’album ressortira le 20 mars chez Ripple Music – NDR)
Le nouvel album de TEMPTRESS, « Hear », est disponible chez Blues Funeral Recordings.

Photos : Amy Seymour (1, 2)