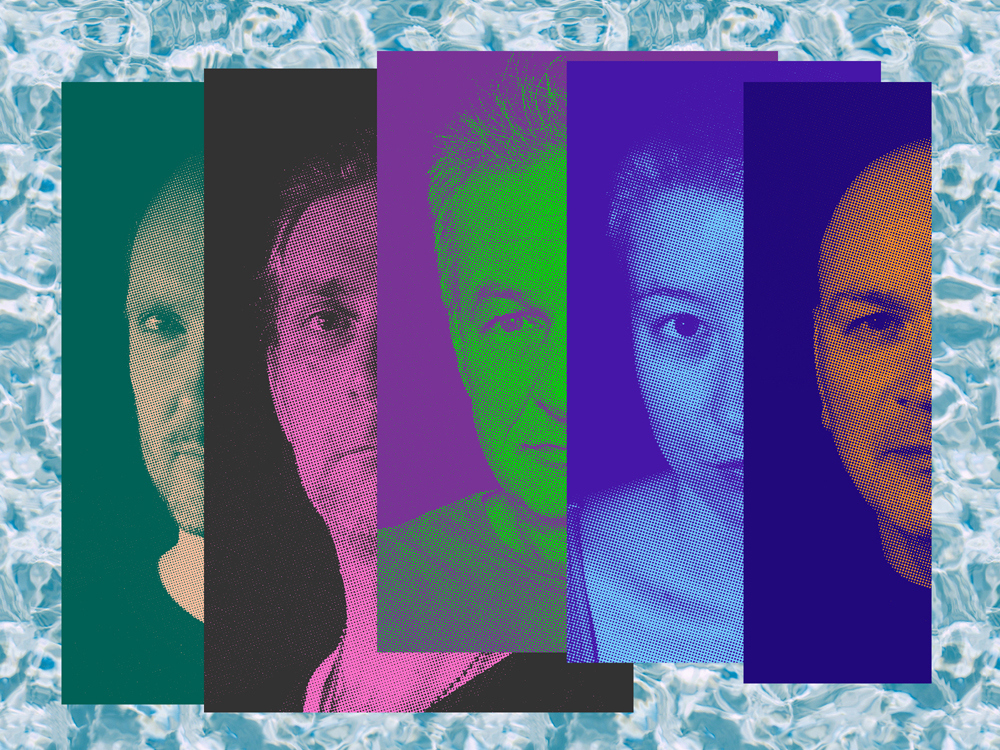Sorti il y a un peu plus de deux mois, « Krystal Metal » marque un bond dans la carrière de la guitariste-chanteuse et fait suite à deux EP, « Brutal Pop I & II » en confirmant un style assez unique où Metal et Pop s’entremêlent naturellement. Egalement productrice, SUN aura pris son temps pour peaufiner son premier long format, ponctué depuis des années par de nombreuses prestations live dont la récente mainstage du ‘Hellfest’. Aguerrie et déterminée, la frontwoman présente un album très abouti et solide sur lequel, vocalement, elle navigue entre un chant clair et un scream ravageur… L’art de conjuguer les opposés. Entretien avec une artiste qui vise toujours plus d’authenticité.

– Tout d’abord, comme tu as récemment fait le festival ‘Kreizh y Breizh’ à Glomel (22) et que tu reviens tout juste du ‘Hellfest’ où tu as joué sur la mainstage, j’aimerais que tu me donnes des impressions. Comment le public Metal t’a-t-il accueilli, et te sens-tu d’une manière ou d’une autre faire partie de cette famille-là ?
Oui, le ‘Hellfest’ s’est très bien passé, au-delà de mes espérances. Il y avait beaucoup de pression sur cette date que j’attendais avec impatience. Et puis, on m’avait dit que lorsqu’on ouvrait une journée sur la mainstage, il arrive qu’il n’y ait pas trop de monde. Et en fait, c’était blindé ! Je n’avais jamais vu ça de ma vie ! J’étais sciée et secouée par ça. Et le ‘Kreizh y Breizh’ juste avant était super sympa, dans une ambiance beaucoup plus bretonne, chaleureuse et très agréable. En ce qui concerne le public Metal, je viens du Metal Extrême à la base, du Brutal Death où je suis guitariste rythmique. Même si mon ‘Brutal Pop’ est un mélange différent, j’ai toujours été bien accueillie par le public, même au ‘Festival 666’ l’année dernière. Je n’avais pas trop peur du côté Metal. En revanche, être sur la mainstage pour mon premier ‘Hellfest’, c’était un peu flippant ! (Rires)
– Il y a six ans déjà, on te découvrait avec un premier EP, « Brutal Pop », suivi en 2023 du second volet, toujours en format court. C’est un univers assez unique, qui va puiser autant dans la Pop que dans des sphères Rock plus musclées. Est-ce que tu te considères un peu comme une sorte de chaînon manquant ? Un pont entre ces deux styles musicaux ?
Peut-être pas, mais c’est assez naturel dans mon processus. Tout ça est né quand j’étais petite, car j’adorais écrire des chansons. Etant franco-allemande, j’habitais en Forêt Noire en Allemagne où je m’ennuyais un peu, mais j’avais accès à la guitare électrique de mon frère et un livre sur la guitare Metal. Et il se trouve que lorsque j’écrivais mes chansons, au lieu de m’accompagner au piano pour plaquer les accords, j’allais directement à la guitare entre la voix et un gros riff. A l’époque, j’écoutais autant Janet Jackson que Hate Eternal ou Morbid Angel, donc des trucs assez vénères. Pour moi, c’était une façon de faire très organique. En fait, au moment de faire la chanson fabriquée autour de ce jeu de guitare et du scream, qui me permet d’atteindre un point culminant sur les paroles, tout cela se fait assez naturellement finalement. Je ne sais pas si je peux me considérer comme un chaînon manquant, c’est plutôt à d’autres de le dire. En tout cas, je suis heureuse si je peux faire le pont, parce que je ne me suis jamais limitée aux styles musicaux. La seule chose que j’aime est le songwriting, donc si c’est seulement un enchainement de riffs, je m’ennuie rapidement.

– Malgré les quatre ans qui les séparent, tes deux premiers EPs se rejoignent et pourraient même constituer un seul et même album, même si des productions sont un peu différentes. Avais-tu besoin de mieux cerner les contours de ton jeu et de ton style avant de t’aventurer dans un format long ?
En fait, j’ai retenu l’album pendant très longtemps. Je ne me suis jamais dit que le ‘Brutal Pop’ serait mon plan de carrière. Pendant des années, j’ai chanté dans des comédies musicales, joué dans des pièces de théâtre, j’ai fait du cinéma en tant qu’actrice… Et tout ça en ayant mon projet à côté. Je ne me suis pas dit que c’était une bonne idée, mais plutôt que j’étais une fille un peu bizarre, voilà ! (Sourires) Ce sont surtout les gens et des producteurs que j’ai rencontrés sur la route comme Dan Levy de The Dø et Andrew Sheps, qui m’ont dit que c’était vraiment ça mon projet. Donc, j’ai vraiment retenu mon album pendant longtemps, parce que je savais que la carte du premier album est quelque chose qu’on ne peut jouer qu’une seule chose. Alors, si on peut le faire partir du plus haut possible de la montagne, c’est plus avantageux. Et c’est pour ça que j’ai aussi mis du temps, car je suis en indépendant et je voulais vraiment trouver les partenaires qui m’aideraient.
– Cela dit, « Krystal Metal » est lui aussi assez court et très resserré. Cherchais-tu un certain sentiment, ou tout au moins une impression, d’immédiateté et d’urgence ?
Pour être sincère, j’ai enregistré beaucoup plus de choses que ce qui figure sur l’album. J’ai vraiment voulu créer le geste qui coulait le mieux avec une grande variété dans les signatures rythmiques, les tempos et les accords pour qu’il n’y ait pas de redites. Et comme je trouvais que ça collait bien, je me suis arrêtée là-dessus, tout simplement.

– Depuis tes débuts, tu t’occupes de tout : de l’écriture à l’interprétation des instruments et du chant jusqu’à la production et le mastering. Tu n’as jamais été tentée de partager tes chansons en groupe, ou avec des arrangeurs par exemple, ou sont-elles trop personnelles à tes yeux ? Ou peut-être que tu as aussi une idée très précise de ce que tu souhaites obtenir ?
En fait, j’ai fait le chemin inverse. Le premier EP a été coproduit avec Dan Levy. Ensuite, j’ai produit le second, mais j’ai travaillé avec des personnes au mix comme Andrew Sheps justement. Lui, il a bossé avec Metallica, Smashing Pumpkins, Beyoncé, … et c’est lui qui m’a dit d’arrêter de me cacher derrière les gens et qu’il fallait que je produise tout de A à Z. Il m’a dit que, comme je savais exactement ce que je voulais, il fallait que je me fasse confiance. Et donc, « Krystal Metal » est vraiment le fruit de tout ça. Tu sais, même avant SUN, je tournais sous mon nom, Karoline Rose. J’ai bossé avec Babx et d’autres et je me suis beaucoup diluée et perdue avec des producteurs, car ils ont tous une vision de toi. C’est bien quand tu fais un truc depuis 20 ans et que tu veux le rafraîchir, ou quand tu es un artiste qui n’a pas trop de matière et que tu es surtout interprète. Mais dans mon cas, ça m’a toujours fait du tort. Et « Krystal Metal » est une sorte de retrouvaille avec moi-même et le meilleur choix de ma vie. Je savais très bien ce que je voulais entendre et je me suis lancée.
– Par ailleurs, tes textes sont souvent engagés, notamment en faveur de la cause féminine, mais pas uniquement. A leur écoute, on découvre aussi beaucoup de colère et de rage. Pourtant, il y a toujours un message d’espoir et surtout une énergie très positive. Ce mélange des genres est-il finalement un appel à l’éveil des consciences à travers un jeu brut et direct ?
J’essaie de rester quand quelque chose de sincère et d’organique, un peu à l’image des disques de Pop qui m’ont marqué et où il y a toujours une accroche direct sur des thèmes universels. Je fais passer ça dans mes chansons et ça traverse des émotions très diverses. J’ai vraiment essayé de faire un disque Pop dans ce sens-là, c’est-à-dire quelque chose que les auditeurs puissent s’approprier. Je laisse sortir les choses avec cette approche-là.

– L’une de tes particularités est d’alterner le chant clair et le scream. C’est un choix qui peut paraître étonnant, même si cela devient aussi très courant sur la scène Metal féminine. Qu’est-ce que cela apporte, selon toi, à tes chanson, car tu pourrais apporter plus de puissance à ton chant clair ?
J’ai cette voix claire qui est assez longue, comme on dit, et qui me donne beaucoup de possibilités et dans ma boîte à outils, j’ai aussi le scream. Et donc à des moments précis où la voix de poitrine ne suffirait plus, je vais laisser le scream venir. Je le fais dès la composition et c’est effectivement souvent lié aux paroles sur une intensité qui arrive, ou un bel accord. La plupart du temps, je le fais à des moments qui sont des points culminants positifs ou majeurs. Ca fait aussi partie de mon registre, tout simplement.
– Ce premier album, « Krystal Metal », vient donc de sortir et la première surprise vient de sa production qui est beaucoup plus organique et se détache de l’aspect assez synthétique de tes deux EPs. C’est pour cette raison que tu as fait appel à un batteur et ponctuellement à un bassiste ? Pour retrouver une certaine chaleur ?
J’ai toujours engagé des musiciens pour les enregistrements en studio, et notamment un batteur, que ce soit sur « Brutal Pop » et « Brutal Pop II ». Le reste, je le fais moi-même. En fait, pour « Krystal Metal », j’ai plutôt fait ce qu’on appelle une ‘non-prod’, c’est-à-dire que je range tous les effets avant qu’on ne les entende. Je ne laisse jamais dépasser ou déborder un réverb’ ou un delay, parce que je veux qu’on écoute la chanson à travers la voix et la guitare. Mais, et cela a été longtemps l’une de mes particularités, c’est parfois une véritable usine à gaz, mais tu ne l’entends pas. C’est important pour moi que la production soit vraiment au service de la chanson et que ce soit l’humain qui joue. C’est vrai que j’ai engagé quelques personnes, mais j’ai aussi beaucoup trifouillé et édité. J’aime avant tout le son organique et ensuite, je passe ma vie à bouger tout ce qu’il a dedans.

– Et puis, il présente également beaucoup plus de profondeur et de consistance avec un spectre sonore plus rempli et massif. Outre le travail sur les morceaux, l’idée était-elle aussi de leur offrir plus de relief et donc de peaufiner le plus possible les arrangements, comme c’est le cas ?
Oui, c’est ça. J’avais vraiment envie qu’il y ait des arrangements, de la largeur, du gros son et à l’époque du Metal moderne, tu as aussi envie de ça. Tu as envie de remplir l’espace, que ce soit massif et aussi, comme je te le disais, de ranger aussi les effets pour les sortir au bon moment. Je préfère qu’on me dise qu’on adore la voix plutôt que la réverb’. Et c’est pareil pour tout, que ce soit au niveau du mix, de la batterie… Les synthés sont là aussi, mais je les ai enregistrés en analogique pour retrouver justement cette chaleur qui me plait beaucoup plus.
– « Krystal Metal » se distingue également par l’utilisation de la double-pédale par ton batteur, de distorsion sur les guitares et ton scream est toujours aussi présent. On se rapproche donc avec ces divers éléments de l’univers du Metal. Justement, d’où viennent tes inspirations de ce registre ? Y a-t-il des artistes ou des groupes qui influent directement sur tes compositions ?
Comme toutes les petites filles, j’ai commencé par les Riot Girls, le Grunge et tout ça. Et comme j’aimais les guitares, j’ai glissé vers le Nu-Metal avec Kitty, My Ruin, Korn, Slipknot ou Machine Head. Et petit à petit, j’ai écouté du Thrash Old comme Testament et très vite, tu arrives à Morbid Angel, Hate Eternal, Immolation ou Cannibal Corpse. C’est vraiment ces groupes-là qui m’ont inspiré niveau Metal. Mais côté ‘mainstream’, il y a Gojira aussi, qui a d’ailleurs été influencé par ces artistes-là. C’est ça qui m’a vraiment parlé, et ensuite Strapping Young Lad et l’album « City » et enfin Devin Townsend, qui est pour moi l’inventeur du Pop Metal à la base. J’ai vite compris que c’était ce mélange-là qui m’intéressait le plus.
– Enfin, à l’avenir, tu comptes rester sur ce registre-là, ou est-ce que tu penses explorer encore d’autres univers musicaux ?
Non, je pense rester là-dessus. En fait, j’ai un peu fait l’inverse du cheminement. Au départ, je ne savais pas vraiment que faire, je ne pensais pas que c’était une bonne idée et plus je sortais des choses, plus j’étais confirmée dans ma démarche. J’essaie d’aller vers toujours plus d’authenticité.
L’album de SUN, « Krystal Metal », et toutes les infos (concerts, etc…) sont disponibles ici : linktr.ee/sunbrutalpop

Photos : Jonathan Lhote (1, 4), Bassem Ajaltouni (2) et Alex Pixelle (3).
Retrouvez la chronique de « Brutal Pop II » :